Bon, je me dois, à moi-même comme à vous, de formuler un pronostic pour 2026. Noblesse oblige. On ne peut pas passer une année entière à sauter de scène en scène avec un deck de tendances, à mi-chemin entre le futurologue et Madame Soleil, sans finir par poser clairement ses jetons (et ses cojones) sur la table. Voilà le moment.
Je regarde l’année à venir avec moins d’optimisme caféiné que l’an dernier, mais avec davantage de clarté structurelle (est-ce que je vieillis, ou est-ce que je suis simplement plus fatigué des foutaises ?). C’est ce qui arrive quand le bruit du changement finit par vous épuiser au lieu de vous séduire. 2025 a été des montagnes russes. IPG a été racheté par Omnicom. OxGen a quitté CG2 pour enfin prendre sa liberté en main. Le cycle techno a mangé sa propre confettisation. La géopolitique est passée des échiquiers de think-tanks directement aux prix dans les rayons. Des politiciens d’ultra-droite tentent leurs tours de passe-passe démagogiques, les États-Unis essaient d’acheter le Groenland, le climat a cessé de demander poliment et a commencé à renverser des choses, et Trump a reçu une médaille de la paix brillante de… la FIFA.
Partout où je regarde, des systèmes qui glissaient autrefois sans effort se mettent maintenant à racler et grincer, et ce grincement, c’est le son de la vérité qui percute la réalité à grande vitesse. Étrangement, je ne suis pas morose. La friction, c’est comme ça qu’on découvre ce qui compte vraiment. Les histoires trop lisses sont bon marché et ennuyeuses. La résistance est honnête. Demandez à n’importe quel fan de Star Wars qui a vécu les préquelles. 2026 ressemble à l’année où les excuses vont brûler, et où seule une pensée opérationnelle, fondée sur une large palette de raisonnements contrarians, survivra.
Je n’entre pas doucement dans cette année. Je m’y prépare. Comme on se crispe quand un train aborde un virage trop vite et qu’on ressent soudain un poids qu’on avait oublié. Le poids des systèmes. Des conséquences. Des décisions non prises. Des promesses élégantes sur des slides qui doivent maintenant survivre au contact de la physique, du droit et de la fatigue humaine. Le poids de dirigeants qui ne dirigent pas, mais espèrent discrètement que tout cela va finir par disparaître (ce ne sera pas le cas). Le poids de ceux qui refusent de repenser les fondations tout en repeignant le hall d’entrée.
Pendant une décennie, nous avons optimisé la fluidité : UX sans friction, croissance sans friction, récits sans friction. Nous avons banni toutes les couleurs, même toutes les nuances de gris… et nous avons perdu l’âme et le leadership. Il s’avère que la friction est l’endroit où vit la vérité. En 2026, tout ce qui compte vraiment vous résiste un peu. L’énergie coûte plus cher. Microsoft et ses neveux SaaS prendront plus d’argent. La confiance prend plus de temps. L’automatisation exige de la gouvernance. Les données sont pénibles. La sécurité est un cauchemar. Survivre signifie repenser l’entreprise depuis ses fondations, pas ajouter un tableau de bord de plus par-dessus. Faire semblant du contraire devient très vite coûteux. Bienvenue dans la société de la sobriété. Et la sobriété, quand elle est partagée, peut être étrangement énergisante.

Évolution sociétale : de la fragmentation à la connexion intentionnelle
« Il ne peut en rester qu’un » sonnait bien dans Highlander. Ça a très mal vieilli. Les plateformes sont toujours là, mais il n’y en a plus une pour les gouverner toutes, et franchement, on devrait s’en réjouir. Nous observons en temps réel ce qui se passe quand trop d’œufs précieux et fragiles se retrouvent dans le même panier, maintenu par des vibes et des incitations trimestrielles. L’ère post-plateforme ne signifie pas la disparition des plateformes. Elle signifie qu’elles cessent d’être suffisantes et, honnêtement, cessent d’être désirables comme points uniques de vérité, d’identité et de subsistance.
Nous continuons de les utiliser, parce que la gravité existe, mais de moins en moins d’organisations sont prêtes à parier tout leur avenir, et la tête de leurs enfants, sur les décisions d’interface sous kétamine prises à trois heures du matin par quelqu’un d’autre (oui, Elon Musk, je te regarde). Le basculement est déjà visible. La valeur se co-crée entre partenaires, fournisseurs, développeurs, régulateurs et parfois concurrents. Les espaces de données industriels en Europe, les API d’open banking, les plateformes logistiques et énergétiques partagées ne sont plus des buzzwords creux, ce sont des mécanismes de survie. L’intelligence se distribue, la prise de décision se fragmente, et la capacité à coordonner intelligemment des systèmes prêts pour l’avenir devient la compétence rare.
L’orchestration d’écosystèmes remplace rapidement la domination de plateforme comme véritable avantage compétitif. Non pas posséder la place du village, mais savoir faire circuler le trafic sans émeutes. Si seulement les politiciens (et certains administrateurs vitrifiés) pouvaient suivre ce raisonnement. Et oui, cela inclut des sujets profondément peu sexy comme les routes maritimes, les organismes de normalisation, de nouveaux contrats sociaux, toute une série de décisions impopulaires, et la question toute simple de savoir qui décroche le téléphone quand quelque chose casse.
L’authenticité se durcit en monnaie, parce que l’imitation bon marché et l’insincérité sont devenues triviales. Quand l’IA peut produire des messages compétents à l’échelle industrielle, la seule différenciation défendable qui reste, c’est la cohérence vécue. Les dirigeants qui disent une chose et en optimisent une autre sont exposés rapidement, non par des scandales, mais par la reconnaissance de motifs. La culture performative s’effondre sous la fatigue de la répétition, les objectifs business délirants et l’absence gênante de preuves de ROI glacées. L’action guidée par des valeurs prend du poids précisément parce qu’elle produit des arbitrages visibles : le deal que vous n’avez pas fait, le marché dont vous êtes sorti, le revenu que vous avez retardé.
Le storytelling compte toujours, peut-être plus que jamais, mais seulement lorsqu’il est ancré dans des choix concrets, des contraintes réelles, des décisions de conseil d’administration et des cicatrices que vous n’avez pas gommées sous Photoshop. Dans un monde saturé d’IA, la spécificité est la confiance.
La culture portée par la communauté passe de « sympa à avoir » à exigence opérationnelle. L’activisme des employés augmente non pas parce que les gens sont soudain devenus radicaux, mais parce qu’ils sont informés, connectés et refusent d’être décoratifs. L’IA de l’ombre les aide à rédiger, analyser, s’organiser et prendre la parole avec moins de peur et plus de précision. La démocratie au travail progresse de façon inégale et parfois maladroite, mais le silence n’est plus un état stable. Les organisations qui ignorent cela créent une bombe à retardement hautement explosive : elles récoltent fuites et feux d’artifice de burn-out.
La gestion de communauté devient une fonction stratégique, interne et externe, parce que le sentiment d’appartenance réduit la volatilité mieux que n’importe quelle enquête d’engagement. Surveiller son score NPS de perception, c’est surveiller son canari dans la mine. Le recrutement et la rétention dépendent de plus en plus de l’alignement des valeurs, en particulier chez les jeunes travailleurs qui ont vu les institutions échouer bruyamment, à répétition, avec une discipline métronomique de PowerPoint.
Oui, la peur d’une armée robotique intelligente est partout, mais la réalité plus discrète est plus intéressante. Les gens n’ont pas peur des machines. Ils ont peur des systèmes qui font semblant de ne pas se soucier de ceux qui sont écrasés quand l’optimisation l’emporte.

Recalibrage politique et géopolitique : naviguer dans un désordre contrôlé
La multipolarité cesse d’être théorique et commence à façonner les factures, parce que la géopolitique est maintenant intégrée aux achats comme la TVA. La compétition États-Unis–Chine est plus qu’un « risque de une » inconséquent : c’est une contrainte sur ce que vous pouvez acheter, où vous pouvez l’acheter, et si vous serez autorisé à l’acheter au prochain trimestre. Les contrôles à l’export sur les semi-conducteurs avancés continuent de se durcir ; le Département du Commerce américain a encore renforcé les contrôles en décembre 2024, puis a mis à jour les règles en janvier 2025 (avec de nouveaux angles, comme des contrôles liés aux “poids” des modèles d’IA). Trump adorerait « mettre à jour » tout ça encore davantage.
Le friend-shoring devient un langage normal du business, parce que les gens aiment l’idéologie commune, mais aussi parce que les conseils d’administration adorent la continuité (et… des marges plus sympas). Et même les droits de douane, l’outil le plus brutal de la boîte, reviennent dans la conversation. Les États-Unis avaient un tarif de 50 % sur les semi-conducteurs chinois entrant en vigueur le 1er janvier 2025, et le dernier bruit en date parle d’une nouvelle trajectoire tarifaire repoussée jusqu’en juin 2027 (évidemment).
L’autonomie stratégique cesse d’être un nom bruxellois et devient une ligne budgétaire dans l’énergie, les chaînes d’approvisionnement de défense et la propriété des infrastructures. Le Sud global ne « choisit pas un camp » autant qu’il choisit du levier. Les pays couvrent leurs risques, commercent et négocient d’une manière qui paraît cynique jusqu’à ce que vous vous rappeliez que le cynisme, c’est souvent juste de la survie avec un meilleur service de presse. Les chaînes d’approvisionnement sont redessinées en fonction du risque politique autant que du coût. Les flux de capitaux deviennent conditionnels. Les exigences de conformité suivent le drapeau. On le sent dans les salles de conseil quand « fournisseur unique » cesse de sonner efficace et commence à sonner irresponsable. Voilà à quoi ressemble un désordre contrôlé : personne ne veut de conflit ouvert, mais tout le monde construit des positions de repli.
La démocratie subit une pression continue, et la pression ne vient pas seulement des élections, elle vient de l’information. La politique post-vérité devient ambiante : un brouillard permanent où les médias synthétiques et les flux fragmentés rendent la confiance fragile par conception. Le “dividende du menteur”, « c’est faux », devient la trappe de sortie universelle, et les fenêtres de communication de crise se réduisent à des minutes parce que les récits se durcissent à la vitesse du scroll. Le stress climatique jette de l’essence sur tout ça. Pressions migratoires, protestations, conflits de ressources : tout brouille la frontière entre crises environnementales et crises politiques, et « stabilité » commence à vouloir dire : « à quelle vitesse peut-on absorber des chocs sans casser la colle sociale ? » La souveraineté numérique monte pour la même raison. Les États réaffirment leur contrôle sur les données, l’infrastructure cloud et les services numériques critiques, en acceptant souvent des coûts plus élevés et moins d’efficacité en échange d’un sentiment de sécurité. Ce n’est pas toujours élégant. Ce n’est pas toujours sage. Mais c’est prévisible.
Pendant ce temps, la régulation s’épaissit plutôt qu’elle ne clarifie, surtout en Europe. NIS2 avait une date limite de transposition au 17 octobre 2024 et a commencé à s’appliquer à partir du 18 octobre 2024, et la Commission a même ouvert des procédures d’infraction contre 23 États membres pour avoir raté l’échéance. DORA (Digital Operational Resilience Act) a commencé à s’appliquer le 17 janvier 2025, et soudain « résilience opérationnelle » cesse d’être une jolie expression et devient des obligations de reporting, des attentes de tests et de la supervision fournisseurs. Et l’AI Act de l’UE n’est plus un monstre abstrait dans le placard : il a un calendrier. Il est entré en vigueur le 1er août 2024, a interdit certaines pratiques à partir du 2 février 2025, déclenche les obligations GPAI à partir du 2 août 2025, et devient pleinement applicable le 2 août 2026 (avec certains domaines “à haut risque” plus tard).
Voilà le basculement : la conformité cesse d’être une affaire “d’éviter des amendes” et devient une affaire “de rester opérable”. Les entreprises qui traitent ça comme de la paperasse vont se noyer dans la paperasse. Celles qui le traitent comme du design de système auront peut-être encore un business quand les règles cesseront d’être une lecture optionnelle.

Maturation technologique : du hype au travail dur
Je prédis que 2026 est l’année où les trucs brillants arrêtent de passer des auditions et commencent à faire des shifts. L’IA agentique marque la vraie transition : les modèles deviennent soudain “éclairés”, et ils arrêtent d’attendre que vous tapiez quelque chose. On dépasse les chat boxes pour aller vers des systèmes qui poursuivent des objectifs, se coordonnent avec d’autres agents, et opèrent à travers des outils et dans le temps. Ça sonne science-fiction (bonjour Stanislaw Lem) jusqu’à ce que vous réalisiez que ça se comporte surtout comme un stagiaire hyperactif avec accès root.
Le plus dur n’est pas “est-ce qu’il peut faire la tâche”, c’est “qui est responsable quand il fait parfaitement la mauvaise tâche ?” L’orchestration multi-agents nous projette directement dans des problèmes de management qu’on a essayé d’ignorer : incitations, budgets, chemins d’escalade, passations, post-mortems, et cette réalité gênante : les modes de panne se multiplient quand on ajoute de l’autonomie. La collaboration humain-IA remonte dans la pile. Les humains fixent l’intention, les contraintes et le jugement. Les machines font l’exécution et le monitoring à une échelle qui donne à votre équipe l’impression d’avancer dans de la boue.
Et l’argent devient bruyant (encore plus). Les dépenses mondiales en IA suivent une trajectoire vers environ 631–632 milliards de dollars d’ici 2028, selon des prévisions IDC. En Europe, IDC estime que les dépenses IA atteindront 144 milliards de dollars d’ici 2028. On a largement dépassé l’argent du hobby chic : c’est maintenant une ligne budgétaire qui se bat pour l’oxygène face aux effectifs et aux usines. L’ère du CFO arrive vite. Les conseils arrêtent d’applaudir les pilotes et commencent à demander des reçus. Les démos sans résultats mesurables se font exécuter discrètement. Ça force un virage vers l’auto-vérification, les tests automatisés et le contrôle qualité autonome, parce que quand les systèmes produisent des outputs à la vitesse machine, les humains ne peuvent pas être la couche de revue.
Pendant ce temps, les géants continuent de couler du béton. Des rapports fin 2025 pointaient plus de 300 milliards de dollars de dépenses data centers liées à l’IA en 2025 chez les grands hyperscalers américains, et la chinoise ByteDance (maison mère de TikTok) budgéterait autour de 23 milliards de dollars d’infrastructure IA pour 2026. Quand autant de capital bouge, “hype” n’est plus le bon mot. C’est de l’infrastructure, maintenant.
L’infrastructure, c’est là où la physique opérationnelle entre en scène. L’Agence Internationale de l’Énergie estime que les data centers utilisent actuellement environ 415 TWh, soit à peu près 1,5 % de l’électricité mondiale, et projette qu’ils pourraient atteindre environ 945 TWh d’ici 2030, juste en dessous de 3 % de l’électricité mondiale. C’est légèrement plus que la consommation électrique du Japon aujourd’hui. Dans l’UE spécifiquement, un explainer de la Commission citant des estimations de l’AIE place la consommation électrique des data centers autour de 70 TWh en 2024, en hausse vers 115 TWh d’ici 2030. Donc oui, l’IA “privacy-first” et on-device gagne du terrain pour des raisons philosophiques, mais aussi pour des raisons brutalement pratiques : latence, conformité, et la suspicion grandissante que “envoyer chaque pensée au cloud” est l’équivalent numérique de faire le trajet pour imprimer un PDF.
Le quantique, pendant ce temps, continue sa marche lente de “tour de magie de conférence” à “niche mais réel”. Il ne remplace pas l’informatique classique : il s’y accroche. Les approches hybrides quantique-classique continuent de montrer du potentiel en science des matériaux, optimisation et premières phases de découverte de médicaments, ces problèmes où l’espace de recherche est un marécage et où la force brute meurt. L’histoire quantique la plus urgente en 2026, c’est la sécurité. Le NIST a déjà finalisé ses premiers standards de cryptographie post-quantique (FIPS 203/204/205), construits à partir de CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium et SPHINCS+, avec FALCON aussi sélectionné pour un standard à venir.
Les organisations sérieuses commencent à inventorier leur cryptographie et à planifier la migration maintenant, parce que “on verra plus tard”, c’est comme ça qu’on se retrouve à changer les serrures alors que les cambrioleurs sont déjà dans le couloir.
Le thème de maturation qui traverse tout ça est simple : moins de feux d’artifice, plus de débats honnêtes sur l’essentiel, plus de plomberie. Le Green IT cesse d’être un signal de vertu et devient de la maîtrise des coûts. Le “carbon-aware computing” devient une expression de procurement, pas de branding. Le hardware circulaire et l’efficacité montent dans la liste des priorités parce que l’électricité, le refroidissement et les chaînes d’approvisionnement sont maintenant des contraintes stratégiques, plus qu’un bruit de fond “PR-isable”. La technologie en 2026 va encore vite, mais les gagnants ne sont pas les plus bruyants (à quoi tu pensais). Ce sont ceux qui savent intégrer autonomie et gouvernance, intelligence et responsabilité, ambition et ces petites limites sales qu’on appelle la physique opérationnelle.

Le paradigme humain-IA : redéfinir le travail et les compétences
Le recalibrage des compétences n’est plus une jolie courbe sur une slide : c’est une (in)commodité quotidienne. L’estimation du World Economic Forum selon laquelle environ 39 % des compétences clés du travail changeront d’ici 2030 n’a pas la même saveur quand on voit des catégories entières de tâches s’évaporer dans un seul cycle de planification. L’IA mange d’abord le milieu : rédaction, synthèse, planification, première passe d’analyse, code junior, le genre de travail qui entraînait le jugement par répétition.
Ce qui reste n’est pas tant du “travail de plus haut niveau” que du travail différent. Donner du sens. Cadrer. Savoir quelle question compte. La pensée stratégique, l’intelligence émotionnelle et la culture systèmes prennent de la valeur parce qu’elles ne se compressent pas proprement en prompts (pas encore). En même temps, les métiers manuels et le travail physique réémergent comme des actifs discrètement stratégiques. Le monde physique est têtu. Les tuyaux fuient. Le béton se fissure. La logistique casse. La réalité a un corps, et les corps comptent encore.
Les voies d’accès “junior” se fracturent de manière lente et dangereuse. Les postes juniors n’ont jamais été seulement du travail bon marché, ils étaient de l’absorption. Ils enseignaient le contexte, le rythme, la politique, la conséquence. Quand l’IA absorbe ce travail fondamental, les organisations risquent de construire des pyramides sans base. Les seniors se retrouvent surchargés. La mémoire institutionnelle s’amincit. Le pipeline de talents pourrit en silence.
Les organisations qui survivent à ça font quelque chose d’inconfortable : elles redesignent l’apprentissage lui-même. Elles associent humains et systèmes IA de manière délibérée, non comme raccourcis, mais comme tuteurs et miroirs. De nouveaux rôles se solidifient vite : formateurs IA qui façonnent les comportements, spécialistes de l’éthique qui définissent des lignes rouges, orchestrateurs qui coordonnent l’effort humain et machine, opérateurs d’agents qui supervisent des systèmes autonomes. Le travail se fait dans des équipes hybrides où la collaboration déborde les personnes, et savoir quand se méfier d’un output devient aussi important que savoir en générer un.
Beaucoup de travailleurs qualifiés répondent en se décalant latéralement plutôt qu’en montant des échelles qui ne mènent plus nulle part. Les carrières portfolio, la micro-entreprise et le conseil indépendant montent, parce que l’IA réduit la distance entre idée et exécution. Une personne avec les bons outils rivalise désormais avec des équipes qui demandaient autrefois budgets, validations et headcount. Le pouvoir se déplace vers ceux qui savent intégrer vite des outils, apprendre sans relâche, et recadrer leur valeur tous les quelques années sans perdre leur colonne vertébrale.
Mais cette flexibilité a un coût psychologique. La réinvention permanente érode la sécurité. La polarisation, la fatigue empathique et la comparaison algorithmique usent les gens. Quand tout semble provisoire, l’expérimentation commence à sembler risquée. Rappel : trois personnes dans le garage de papa peuvent sauver le monde (ou le faire exploser).
C’est là que beaucoup d’organisations se plantent. Elles courent après la capacité et oublient la sécurité. L’innovation ne meurt pas parce que les gens manquent d’outils. Elle meurt parce que les gens cessent de faire confiance au sol sous leurs pieds. Reconstruire la sécurité psychologique, c’est des attentes claires, un rythme humain, du temps protégé pour apprendre, et des leaders qui tolèrent l’échec intelligent sans théâtre performatif.
Dans le paradigme humain-IA, la vitesse sans sécurité produit du burn-out. La capacité sans appartenance produit du churn. Mais la capacité couplée à la sécurité produit quelque chose de rare et précieux : l’endurance. Et dans une décennie qui n’arrête pas d’accélérer, l’endurance est peut-être la compétence la plus sous-cotée de toutes.

Transformation du leadership : les soft skills comme puissance dure
Le leadership en 2026 cesse d’être une affaire d’autorité et devient une affaire d’architecture. La “raison d’être” évolue d’un poster au mur vers un système d’exploitation qui gouverne discrètement les décisions quand personne ne regarde. Les leaders qui traitent la purpose comme un slogan de campagne brûlent vite leur crédibilité, parce que l’incohérence voyage désormais à la vitesse des algorithmes. Les architectures de décision encodent de plus en plus mission, valeurs et impact long terme dans la logique d’investissement, les règles d’achats et les roadmaps produits.
Certaines organisations expérimentent des rôles qui ressemblent fortement à des Chief Value Officers, non pas pour polir la réputation, mais pour forcer les conséquences éthiques, sociétales et long terme dans les arbitrages du board au lieu de les sous-traiter à la RP après coup.
Le leadership visionnaire fait un retour inattendu : les leaders qui comptent, pensent de travers et parfois de manière hérétique. Ils posent des questions qui mettent les salles mal à l’aise. Ils défient des KPI sacrés. Ils montent de petites unités “opérations spéciales” semi-autonomes au sein de leurs organisations : des équipes explicitement conçues pour repenser comment le travail se fait, comment la valeur se crée, et quelles hypothèses ne tiennent plus. Ces unités sont protégées de la politique du quotidien et mesurées sur la vitesse d’apprentissage et l’insight, pas sur la production trimestrielle. C’est de la pensée contrarienne avec des garde-fous, et c’est l’une des rares façons pour les grandes organisations d’éviter de se calcifier sous leur propre succès.
Les généralistes redeviennent pertinents parce que la complexité punit l’étroitesse. Les penseurs transdisciplinaires connectent technologie, finance, régulation et culture sans couches de traduction. Ils cassent les silos par pensée système plutôt que par ateliers et Post-its. Les fusion teams, qui mélangent business, technique, légal et expertise humaine par design, deviennent la norme dans les organisations qui veulent aller vite sans se casser. La gestion de crise se durcit en compétence centrale. La planification de scénarios continue remplace l’exercice annuel “table-top”, et la communication transparente bat la panique réactive quand les choses tournent inévitablement de travers.
L’influence authentique remplace l’autorité de position. Les gens suivent des leaders qui “font sens” sous pression, pas ceux qui performent la confiance. La vulnérabilité, quand elle est ancrée et non performative, construit la confiance parce qu’elle signale la conscience du réel plutôt que la faiblesse. Les leaders qui privilégient la résilience plutôt que l’optique, la cohérence plutôt que le charisme, et la santé long terme plutôt que les applaudissements court terme gagnent un followership qui survit à la turbulence. Les soft skills cessent d’être “soft” au moment où les systèmes se tendent. En 2026, ce sont des poutres porteuses.

Réinvention de la communication : la vérité à l’ère post-vérité
Chaque organisation devient une entreprise média, qu’elle ait demandé le poste ou non. Le silence communique désormais aussi fort que la parole, et la répétition aussi. Le volume de storytelling explose parce que l’IA rend la production bon marché, rapide et infinie, mais cette abondance aplatit tout. Ce qui perce n’est pas le vernis, c’est l’humanité. L’imperfection, la spécificité et le contexte deviennent des différenciateurs parce qu’ils sont plus difficiles à falsifier à grande échelle. La confiance naît du fait de montrer son travail : comment les décisions ont été prises, quelles options ont été écartées, où ça a cassé, et ce qui a été appris. Les entreprises qui publient leurs raisonnements, leurs arbitrages, et même leurs échecs construisent plus de crédibilité que celles qui courent après la perfection esthétique et le néant “brand-safe”. Dans un monde qui se noie dans une similarité générée, la texture devient la vérité.
Les comportements de recherche se fragmentent d’une manière qui terrorise discrètement les équipes de communication traditionnelles. Un insight interne de Google bien documenté dès 2022 montrait déjà qu’environ 40 % des utilisateurs de la Gen Z se tournaient vers des plateformes sociales comme TikTok et Instagram plutôt que vers Google Search ou Maps pour la découverte, et ce comportement n’a fait que se normaliser depuis. La recherche devient sociale, visuelle, contextuelle et assumée comme opinionnée. En parallèle, les newsletters, podcasts et petites plateformes communautaires regagnent du pouvoir parce qu’elles offrent continuité et voix. Les contenus sérialisés et les narrations à base de lore performent mieux que les annonces isolées parce qu’ils récompensent l’attention dans la durée. La communication cesse de se comporter comme un calendrier de campagnes et commence à se comporter comme une relation : lente à construire, rapide à briser, et impossible à feindre de manière cohérente.
L’ambition visuelle grimpe fortement à mesure que les outils abaissent la barrière de l’expression cinématographique. L’IA permet le micro-cinéma, l’animation, la traduction et le remix à un coût qui aurait été risible il y a cinq ans. Les marques expérimentent des formats immersifs, des récits interactifs et des réponses visuelles en temps réel. Mais les mêmes outils inondent l’écosystème de bouillie à faible effort. La guerre de l’information s’intensifie non par le génie, mais par le volume. Le signal se retrouve enterré sous un bruit compétent. Résultat : la détection du signal devient une compétence professionnelle. Des plateformes comme Reddit jouent de plus en plus le rôle de systèmes d’alerte précoce, faisant remonter contradictions, glissements de sentiment et récits émergents avant qu’ils n’atteignent les canaux mainstream. La vérification et le fact-checking sortent du journalisme pour devenir une compétence opérationnelle quotidienne dans les entreprises, non par posture morale, mais par instinct de survie. En temps de post-vérité, la crédibilité ne se proclame pas. Elle se gagne en continu, message cohérent et vérifiable après message.

Climat et durabilité : l’adaptation devient urgente
L’adaptation sort enfin du débat moral pour entrer dans la salle des machines. Pendant des années, le climat vivait au futur, quelque chose dont on s’occuperait après le prochain trimestre, la prochaine élection, la prochaine percée technologique. En 2026, il passe au présent. La planification d’adaptation intégrée de l’Union européenne pousse la résilience au cœur même des infrastructures, de l’agriculture, des systèmes d’eau et du design urbain. Il ne s’agit pas d’atteindre des pourcentages abstraits sur une slide. Il s’agit de routes qui ne se déforment pas à 45 °C, de ports capables d’opérer avec des niveaux de la mer plus élevés, de villes qui peuvent survivre à une semaine de dôme de chaleur sans se transformer en services d’urgence permanents. Les trajectoires régionales remplacent les objectifs universels parce que la réalité est obstinément locale. Les inondations en Belgique, la sécheresse dans le sud de l’Espagne, les incendies en Grèce ne sont pas des variations d’un même problème. Ce sont des systèmes différents qui échouent de façons différentes.
Le risque climatique devient un risque financier d’une manière qui traverse enfin l’idéologie. L’assurance est le système d’alerte précoce, et il clignote rouge. Dans les régions exposées aux inondations et aux incendies à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, les primes explosent ou la couverture disparaît tout simplement, pas dans dix ans, maintenant. Quand une maison ou une usine devient inassurable, elle devient non finançable. Les banques le remarquent. Les modèles de crédit commencent à intégrer le risque climatique physique dans les évaluations long terme, poussant les coûts d’emprunt à la hausse et les flux d’investissement sur des trajectoires latérales. Le capital fait ce qu’il a toujours fait : il fuit l’incertitude et va vers la résilience. Soudain, les budgets d’adaptation ressemblent moins à de la dépense environnementale et plus à de la défense de bilan.
L’histoire des 1,5 °C ne disparaît pas, mais elle perd sa netteté rassurante. Le dépassement est de plus en plus reconnu, discrètement, dans des briefings techniques plutôt que dans des communiqués de presse. La conversation passe de la prévention seule à la limitation des dégâts et à la capacité d’adaptation. Quelle chaleur une main-d’œuvre peut-elle encaisser ? Quels actifs renforce-t-on, lesquels relocalise-t-on, lesquels abandonne-t-on ? Les investissements s’accélèrent vers les défenses contre les inondations, les bâtiments résistants à la chaleur, le recyclage de l’eau, les infrastructures de refroidissement et les solutions fondées sur la nature comme les zones humides ou les corridors verts urbains qui absorbent les chocs tout en faisant gagner du temps. Ce ne sont pas des projets romantiques. Ce sont des amortisseurs pour un système sous contrainte.
Dans cet environnement, la durabilité cesse d’être une question d’intention et devient une question de preuve. Les promesses vertes sans données se dégradent instantanément. Ce qui conserve de la valeur, ce sont des chiffres d’émissions transparents, des plans de transition crédibles et une résilience démontrable sous stress. Les entreprises capables de montrer comment elles opèrent pendant des vagues de chaleur, des sécheresses, des ruptures d’approvisionnement et une volatilité énergétique gagnent la confiance des assureurs, des investisseurs et des employés. En 2026, la question n’est plus de savoir si vous vous souciez du climat. C’est de savoir si votre organisation fonctionne encore quand le climat cesse d’être gentil.

Innovation des modèles économiques : repenser la création de valeur
Les modèles économiques lâchent enfin le fantasme de la plateforme et mûrissent en écosystèmes. Posséder l’interface ne suffit plus, et n’est souvent même plus désirable. La valeur émerge désormais par l’interopérabilité, les standards partagés et la co-création délibérée à travers des réseaux de partenaires, fournisseurs, développeurs et clients. On le voit dans l’open banking, dans les espaces de données industriels, dans les marchés de l’énergie qui équilibrent production, stockage et consommation entre de multiples acteurs. Les entreprises apprennent à jouer dans plusieurs écosystèmes à la fois, parfois même avec des concurrents, sans se dissoudre en bouillie stratégique. La compétence clé n’est pas la domination. C’est la cohérence. Savoir où l’on s’ancre, où l’on se branche, et où l’on refuse la dépendance.
L’économie orientée résultats se diffuse parce que les clients en ont fini de payer pour du potentiel. Ils paient pour des résultats, de la disponibilité, des gains d’efficacité, des réductions d’émissions, des risques évités. Ce n’est pas un virage philosophique, c’est un virage contractuel durement négocié. Les SLA évoluent vers des accords au niveau des résultats, et la mesure continue devient soudain partie intégrante du produit. Si vous ne pouvez pas prouver la valeur dans le temps, vous n’êtes pas renouvelé. L’automatisation s’insinue jusque dans la comptabilité de la valeur elle-même, suivant l’impact en quasi temps réel plutôt qu’en post-mortems trimestriels. Cela change la manière dont les produits sont conçus, dont les prix fonctionnent et dont la confiance est maintenue, parce que les chiffres sont toujours visibles.
Les choix d’infrastructure cessent d’être purement techniques et reflètent des préoccupations de souveraineté et de survie. Les architectures hybrides cloud-edge équilibrent contrôle, latence, contraintes réglementaires et résilience. Les données qui ne peuvent pas quitter une juridiction restent proches de leur lieu de production. L’intelligence en temps réel se déplace vers l’edge parce que la physique compte toujours. Les stratégies multi-cloud servent moins à gratter des coûts qu’à couvrir des risques : verrouillage fournisseur, tensions géopolitiques, points de défaillance uniques. Le modèle économique n’est plus seulement ce que vous vendez. C’est la robustesse de votre création de valeur quand l’environnement cesse d’être favorable.

Culture organisationnelle : le véritable différenciateur
La culture cesse d’être un “soft topic” quand les systèmes tournent à plein régime. J’espère sincèrement qu’en 2026, le bien-être ne sera plus présenté comme de la gentillesse, mais comme de la capacité. Le soutien à la santé mentale, l’intégration réelle de structures de travail flexibles pour les profils neurodivergents, et l’émergence de troisièmes espaces entrent dans les modèles opérationnels standards, parce que le burn-out est coûteux et mesurable. L’Organisation mondiale de la santé estime déjà que la dépression et l’anxiété coûtent plus de 1 000 milliards de dollars par an à l’économie mondiale en perte de productivité, et les organisations commencent enfin à relier ce chiffre à leurs propres tableaux de bord d’attrition. Le burn-out cesse d’être traité comme un échec de résilience individuelle et commence à être reconnu comme un défaut de conception du système : trop de charge, pas assez de récupération, priorités floues, urgence permanente. Le corriger exige de redessiner le travail, pas d’ajouter une énième application de pleine conscience.
La reconnaissance et le sentiment d’appartenance surpassent discrètement les avantages matériels. Les déjeuners gratuits, la table de ping-pong, les goodies corporate et les packages de rémunération gonflés perdent leur pouvoir d’attraction quand les gens se sentent invisibles ou jetables. Les données Gallup montrent de manière constante que les employés qui se sentent reconnus sont nettement plus engagés et moins enclins à partir, et en 2026 cette corrélation devient une stratégie. Les moments partagés, les rituels et la reconnaissance visible créent de la mémoire, et la mémoire crée de la loyauté. La communauté devient le véritable moteur de l’engagement : réseaux internes, reconnaissance par les pairs et jalons collectifs remplacent l’inflation des perks comme colle dans les périodes de changement. Le sentiment d’appartenance réduit la volatilité mieux que n’importe quelle prime de rétention.
Forcer le retour au bureau est rarement une position culturelle audacieuse. Le plus souvent, c’est un échec managérial déguisé en posture assurée. Cela signale une incapacité, ou un refus, de faire le travail plus difficile consistant à concevoir des systèmes hybrides qui fonctionnent réellement. Le véritable avantage du travail distribué n’a jamais été « travailler en pyjama », mais la confiance, l’autonomie et l’accès à des viviers de talents plus larges, combinés à des moments intentionnels de rassemblement qui renforcent le collectif. La culture ne se crée pas par des badgeuses obligatoires ou des parkings pleins. Elle se crée par une raison d’être partagée, des attentes claires et des environnements où les individus sont traités comme des adultes avec des vies, des cycles d’énergie et des manières différentes de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Les organisations qui appliquent par défaut des politiques de retour au bureau généralisées révèlent généralement qu’elles n’ont jamais appris à diriger sans contrôle visuel. L’or managérial est ailleurs. Il se trouve dans la conception d’écosystèmes socio-techniques où les équipes savent quand se réunir, pourquoi c’est important et ce qu’elles construisent ensemble, tout en respectant la concentration individuelle, la flexibilité et la dignité. Ce type de culture ne crie pas. Il se capitalise.
L’apprentissage continu s’intègre dans l’ADN organisationnel parce que la stagnation devient un passif. L’upskilling passe d’avantage RH à stratégie de rétention, à mesure que les rôles évoluent plus vite que les intitulés de poste. Les humains apprennent de plus en plus aux côtés de systèmes d’IA, non seulement à les utiliser, mais à les questionner, les corriger et les superviser. L’apprentissage devient partie intégrante du flux de travail, pas quelque chose qu’on cale entre deux crises. Les organisations qui normalisent l’expérimentation et l’adaptation construisent de la confiance plutôt que de la peur. L’adaptation cesse d’être une initiative avec une date de lancement et devient une habitude : pratiquée discrètement, rarement annoncée, et absolument décisive quand l’environnement change à nouveau.

Le défi de l’intégration : faire fonctionner l’ensemble
L’intégration est l’endroit où les stratégies deviennent soit banalement efficaces, soit bruyamment mortelles. En 2026, la plupart des grandes organisations ne manquent plus d’idées, de pilotes ou de frameworks. Elles en sont noyées. L’entreprise moyenne exploite déjà des centaines d’outils SaaS, des dizaines d’expériences IA, plusieurs régimes réglementaires et des programmes de transformation parallèles qui se parlent à peine. La stratégie cesse d’être un choix d’initiatives et devient une conception de système d’exploitation capable de supporter la charge. Les projets sont temporaires. Les systèmes d’exploitation persistent. L’avantage compétitif se déplace vers ceux qui savent coudre l’IA, l’IT historique, la régulation, la cybersécurité, la culture, la finance et les incitations dans quelque chose qui fonctionne réellement un mardi après-midi, pas seulement lors du séminaire annuel.
La gouvernance doit mûrir vite. La complexité n’est plus exceptionnelle, elle est la norme. Les organisations qui gagnent ne sont pas les plus “agiles” au sens buzzword, mais celles qui prennent des décisions rapides sans perdre le contrôle. Cela implique des responsabilités claires, des arbitrages explicites et des chemins d’escalade qui fonctionnent avant que quelque chose ne prenne feu. Les récits d’échec ne manquent pas. Regardez l’aviation, la finance, la santé. La plupart des défaillances ne sont pas causées par une seule mauvaise technologie, mais par des transmissions, des vides et des hypothèses entre des systèmes qui n’ont jamais été conçus pour coexister. L’intégration n’est pas un problème technique. C’est un problème organisationnel, et il est impitoyable avec le flou.
La confiance devient la ressource la plus rare et la plus chère dans cet environnement. Les baromètres de confiance montrent depuis des années la fragilité de la confiance envers les institutions, mais en 2026 cette fragilité devient un risque opérationnel. Les clients hésitent. Les employés divulguent. Les régulateurs scrutent davantage. La transparence cesse d’être un exercice de communication et devient un comportement sous stress. Vos incitations correspondent-elles à vos valeurs quand le chiffre d’affaires est en jeu ? Vos systèmes d’IA se comportent-ils en production comme lors de la démo ? Vos fournisseurs respectent-ils les standards que vous prétendez imposer ? La confiance ne se construit plus en disant les bonnes choses une fois. Elle se construit en étant ennuyeusement cohérent à travers produits, personnes, données et décisions.
La pensée long terme devient paradoxalement un avantage concurrentiel précisément parce qu’elle est devenue rare. Les marchés publics continuent de récompenser la performance trimestrielle, mais l’infrastructure, les capacités IA, la résilience énergétique et les pipelines de talents fonctionnent sur des horizons de plusieurs décennies. Les entreprises qui investissent tôt dans l’intégration, des fondations de données propres, la préparation réglementaire et les capacités humaines paraissent plus lentes au début. Puis l’environnement se durcit, et soudain ce sont les seules qui avancent encore. Ce n’est pas de l’idéalisme. C’est l’intérêt composé appliqué au design organisationnel.
La vérité inconfortable, c’est que la plupart des travaux d’intégration sont invisibles. Ils ne se démontrent pas bien. Ils ne rentrent pas dans un keynote. Ils se manifestent par moins d’incidents, une récupération plus rapide, moins de friction et des nuits plus calmes. En 2026, ce calme devient un luxe. Construire pour des décennies plutôt que pour des trimestres n’est plus une posture morale, c’est une stratégie de survie. L’héritage, pas l’optique, devient le vrai tableau de score. Et les organisations qui l’acceptent tôt découvrent que la cohérence, une fois atteinte, est extraordinairement difficile à copier.
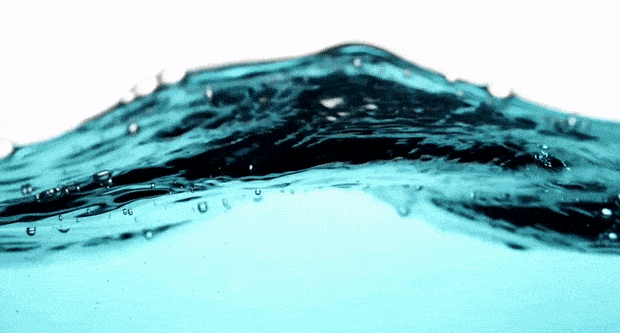
La facture cachée : le coût des nouvelles technologies
La facture du progrès arrive enfin, et elle est vertigineuse. L’IA n’est plus seulement une histoire de logiciel, c’est une histoire d’infrastructure dure comme l’os, et l’infrastructure envoie toujours l’addition quelque part de très physique. Les data centers consomment déjà environ 1 à 2 % de l’électricité mondiale, et plusieurs projections crédibles s’attendent à ce que cette part double d’ici la fin de la décennie à mesure que les charges IA explosent. Un seul data center hyperscale peut tirer autant d’électricité qu’une ville de taille moyenne, et contrairement aux villes, il ne vote pas. L’entraînement des modèles de pointe brûle des dizaines de gigawattheures, et l’inférence, celle qu’on prétend peu coûteuse, tourne 24/7. Le refroidissement transforme l’électricité en politique de l’eau. Dans des régions soumises à la sécheresse comme le sud-ouest des États-Unis, certaines zones d’Espagne ou le nord du Mexique, les data centers refroidis à l’eau concurrencent désormais directement l’agriculture et les ménages.
Nous avons besoin d’actions de durabilité sévères et rapides, pas de discours sans fin. Nous avons besoin d’audiences de zonage, de permis d’urgence, de chiffres réels, de régulations, et d’élections locales perdues à cause de racks de serveurs mal positionnés.
L’énergie n’est que la première ligne de la facture. La facture éthique grossit silencieusement et se capitalise. L’automatisation ne supprime pas seulement des emplois, elle fait s’effondrer des échelles de carrière. Elle en détruira davantage dans un avenir très proche. Les rôles d’entrée de gamme en marketing, droit, finance et logiciel sont vidés plus vite que les systèmes de reconversion ne peuvent compenser. Le World Economic Forum estime que, même si l’automatisation crée de nouveaux rôles, des millions de travailleurs devront changer de métier d’ici 2030, et c’est dans ces transitions que les gens tombent entre les mailles. Quand le travail junior disparaît, les pipelines de mentorat se brisent, la mémoire institutionnelle s’amincit, et on risque de perdre toute une génération de professionnels qualifiés avant même qu’elle ne se stabilise.
La gouvernance peine à suivre, et l’aléa moral est évident. Il est très facile de déployer des systèmes qui externalisent discrètement les dommages, parce que le coût n’apparaît pas sur le P&L ce trimestre.
Les pertes d’emplois sont inégales, et c’est ce qui les rend déstabilisantes. Les pôles technologiques s’adaptent. Les régions périphériques se vident. Les travailleurs très qualifiés gagnent en levier pendant que d’autres restent coincés avec des options qui se rétrécissent. Les gains de productivité se concentrent dans les entreprises qui possèdent modèles, calcul et données, tandis que les coûts d’ajustement sont répartis entre des communautés, des écoles et des familles qui n’ont jamais signé pour l’expérience. C’est ainsi que les contrats sociaux s’effilochent, non pas dans un fracas, mais dans ce sentiment croissant que le système s’optimise autour de vous, pas pour vous. Ignorer la facture ne la fait pas disparaître. Ça ajoute juste des intérêts. Et les intérêts, comme toute personne ayant manqué une échéance le sait, sont impitoyables.
La vérité inconfortable est la suivante : nous menons l’une des transitions technologiques les plus ambitieuses de l’histoire sans avoir terminé la plomberie. Les réseaux énergétiques accusent un retard sur l’ambition. Les politiques de l’eau accusent un retard sur les déploiements. Les systèmes éducatifs accusent un retard sur les marchés du travail. L’éthique accuse un retard sur les incitations. Rien de tout cela ne signifie qu’il faut s’arrêter. Cela signifie qu’il faut arrêter de prétendre que le coût est théorique. Le progrès vaut toujours le coup. Mais seulement si nous sommes assez adultes pour admettre que quelqu’un paie toujours, et pour décider, délibérément, qui ce quelqu’un sera.
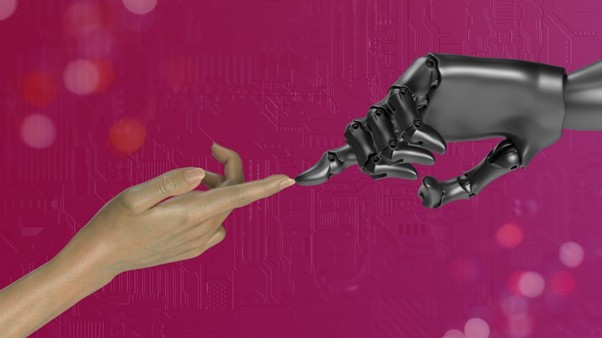
Le prochain acte de l’IA : agents, mondes et bataille des géants
L’évolution de l’IA accélère vers l’autonomie. La phase suivante ne consiste pas à “avoir l’air plus intelligent”, mais à se comporter différemment. L’accélération va vers l’autonomie, et les facilitateurs discrets comptent plus que les démos tape-à-l’œil. La génération augmentée par récupération (RAG) devient une infrastructure ennuyeuse, et c’est exactement le but. Ancrer les modèles dans des connaissances vérifiées et auditables transforme l’hallucination d’un risque existentiel en un problème de système. Les Model Context Protocols (MCP) vont dans la même direction, en standardisant la façon dont les modèles parlent aux outils, à la mémoire, aux permissions et entre eux. C’est de la plomberie, pas de la poésie, mais c’est cette plomberie qui permet aux agents d’agir de manière cohérente à travers les workflows au lieu d’improviser jusqu’à la catastrophe. Quand on combine RAG, MCP, mémoire long terme et accès aux outils, on cesse de construire des chatbots et on commence à assembler des acteurs numériques persistants.
Cette persistance change tout. Les agents cessent d’être transactionnels et deviennent situationnels. Ils planifient, simulent, révisent et se coordonnent. C’est là que les modèles du monde entrent dans la conversation : des systèmes qui ne se contentent pas de prédire le prochain token, mais maintiennent une représentation interne du fonctionnement du monde. Cause et effet. Physique. Contraintes. Boucles de rétroaction. Yann LeCun, l’un des architectes du deep learning moderne, a été très clair à ce sujet. Il affirme que les grands modèles de langage actuels manquent de véritable compréhension et que le progrès vers une intelligence plus générale nécessite des modèles capables de raisonner sur le monde, pas seulement sur le langage qui en a été extrait. Qu’on adhère ou non à son cadrage, la direction est limpide. La simple prédiction de texte atteint un plafond. La simulation change la donne.
À mesure que l’autonomie augmente, les frontières organisationnelles commencent à se brouiller. On voit déjà apparaître les premiers contours de responsabilités hybrides RH–DSI, parce que gérer des agents commence à ressembler étrangement à gérer une main-d’œuvre. Intégration d’acteurs non humains. Définition des permissions. Budgets. Journalisation des actions. Audit des comportements. Évaluation des performances. Quand un agent planifie du travail, négocie avec des fournisseurs, touche aux données clients ou déclenche des actions financières, ce n’est plus seulement de l’IT. C’est de la gouvernance, de la conformité et du management des personnes… sans les personnes. Les organisations qui comprennent cela tôt cessent de traiter l’IA comme une catégorie d’outil et commencent à la traiter comme une nouvelle classe d’acteur organisationnel. Celles qui ne le font pas se retrouvent avec des agents fantômes effectuant un travail fantôme hors de tout contrôle réel.
Pendant ce temps, la bataille entre les géants s’intensifie avec des conséquences bien concrètes. OpenAI, Google, Meta et Microsoft investissent des dizaines de milliards dans le calcul, les talents et l’infrastructure, non par curiosité, mais parce que l’échelle détermine désormais qui fixe les standards par défaut. Celui qui contrôle les modèles dominants, les protocoles et les écosystèmes finit par écrire les règles auxquelles le reste du monde s’adapte. Cette concentration rayonne vers l’extérieur. Le pouvoir se centralise. Les dépendances se creusent. L’enchevêtrement géopolitique s’intensifie, car le calcul, l’énergie et les bassins de talents deviennent des actifs stratégiques plutôt que des intrants neutres.
L’intelligence artificielle générale reste contestée, mal définie et lourdement mythifiée. Mais se focaliser sur l’étiquette rate l’essentiel. Ce qui compte, ce n’est pas de savoir si un système franchit un seuil philosophique, mais quelle agence on lui donne, sous quelles contraintes, et avec quelle supervision. Des systèmes capables de planifier, simuler et agir à grande échelle n’ont pas besoin d’être “généraux” pour être disruptifs. Il suffit qu’ils soient déployés sans freins. Que ce prochain acte amplifie les capacités humaines ou approfondisse la dépendance dépend moins de l’architecture des modèles que de la gouvernance, des incitations et des choix de design faits maintenant. L’autonomie sans responsabilité n’est pas de l’intelligence. C’est juste de la vitesse avec des conséquences.
La vérité inconfortable, c’est que nous ne courons pas vers un moment de percée unique. Nous dérivons vers un nouvel équilibre, protocole après protocole, agent après agent, délégation après délégation. La question pour 2026 n’est pas « l’IA sera-t-elle plus intelligente ? ». Elle le sera. La question est de savoir qui décide de la liberté accordée à ces systèmes, comment leurs actions sont contraintes, et qui porte le poids quand ils se trompent. C’est là, bien plus que dans n’importe quel score de benchmark, que se joue la vraie bataille.

La friction est le nouveau noir (qui était l’ancien vert)
Je reviens sans cesse à ce même confort inconfortable : la friction est honnête. C’est le bruit qu’un système fait quand il doit enfin porter son propre poids. En 2026, nous ne pourrons plus externaliser ce poids à “l’innovation”, à “la culture”, ou à un fournisseur avec un PDF brillant. Il faudra construire des choses qui survivent aux mardis. Des choses qui se comportent en production comme elles se comportaient dans la démo. Des choses auditables, bridables, arrêtables, explicables. De la vraie gouvernance. De vraies équations énergétiques. De vraies limites humaines. De la vraie responsabilité.
La bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c’est que c’est exactement là que se construit l’avantage adulte. Pas en criant “AI-first” comme un cri de guerre, mais en concevant l’orchestration, les incitations et la confiance comme on conçoit un pont. On suppose le stress. On suppose la météo. On suppose les idiots. Et on construit quand même. Si votre organisation ne peut pas dire la vérité à la vitesse du scroll, ne peut pas mesurer la valeur sans théâtre, ne peut pas préserver les humains pendant que les machines accélèrent, alors 2026 ne sera pas une année difficile. Ce sera un chapeau de sélection.
Voici donc mon pari : les gagnants seront les ennuyeux. Ceux qui gardent les reçus. Ceux qui investissent dans la plomberie. Ceux qui traitent la confiance comme un actif et l’énergie comme une contrainte. Ceux qui arrêtent de repeindre le hall et réparent enfin les fondations. La friction est notre amie-ennemie cette année.
Elle est l’épreuve. Et elle est le professeur.